1922 |
Entre l'impérialisme et la révolution
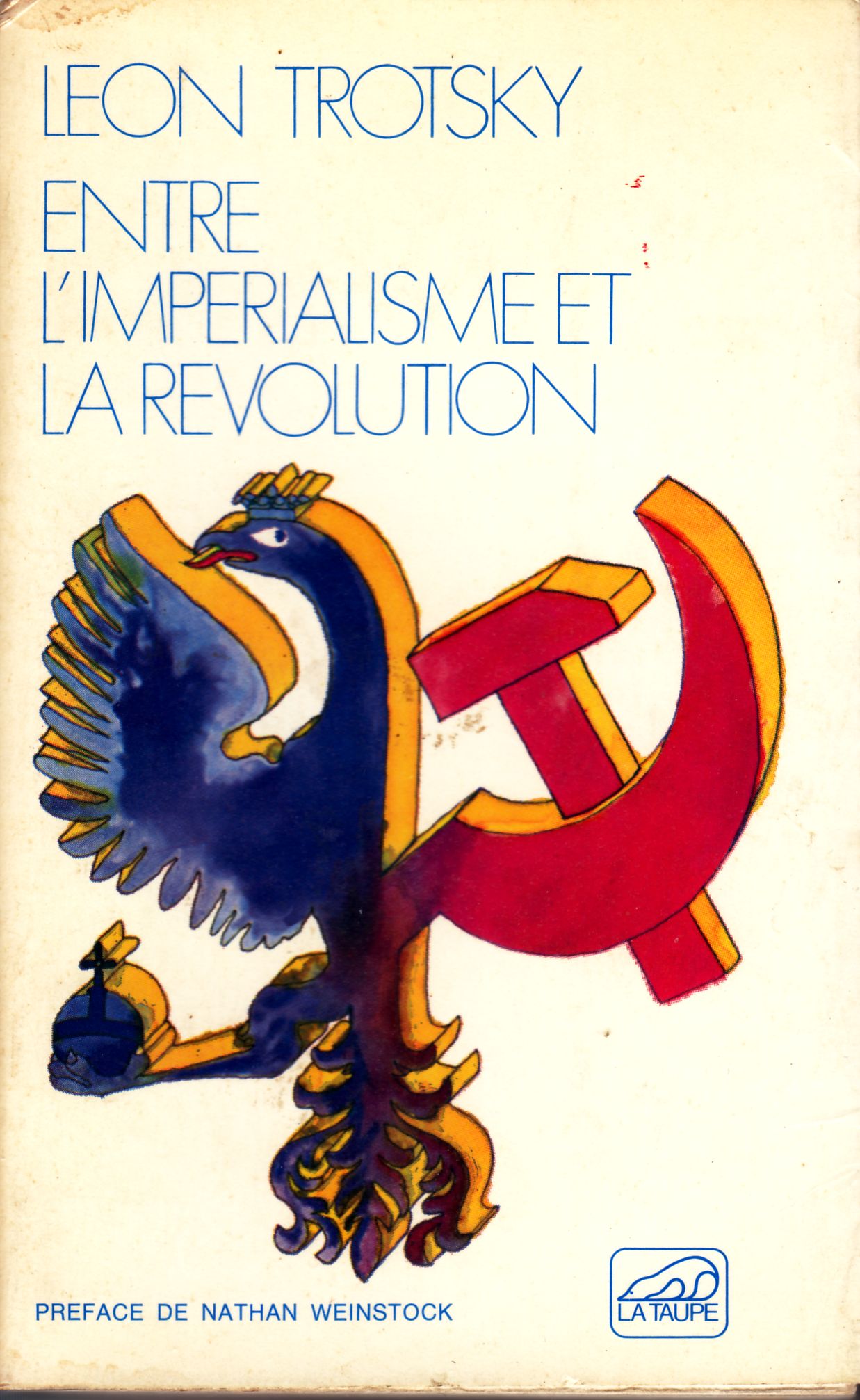
chapitre III.
Ainsi, en politique extérieure, la stricte neutralité et, en politique intérieure, bien entendu, la plus entière liberté. D’ailleurs, comment pourrait-il en être autrement ? « Les rapports entre les ouvriers et les paysans de Géorgie — raconte Kautsky — sont jusqu’à présent les meilleurs du monde » (p. 54). Du Rhin à l’Océan Pacifique, les insurrections ensanglantent le monde et « la Géorgie est le seul pays qui, avec l’Autriche allemande, n’ait point été le théâtre de la violence. » Et les communistes ? « Légalement reconnus et jouissant d’une complète liberté d’action », ils n’ont pu pourtant acquérir aucune influence (p. 65). Les social-démocrates ont obtenu à toutes les élections une écrasante majorité de voix. Voilà bien, en effet, le pays unique en son genre, de l’Océan Pacifique au Rhin ! D’ailleurs, au-delà du Rhin, on aurait peine également à trouver un pays semblable, si ce n’est la principauté de Monaco, telle que la représentent les fossiles pensionnés de l’Académie française.
Devant une telle croûte politique, on s’arrête tout d’abord, paralysé, comme devant une de ces impertinentes gravures polychromes dont chaque couleur séparément est fausse, et dont l’ensemble est d’une fausseté qui blesse encore davantage les yeux. Tout ce que nous connaissons des origines de la Géorgie autonome et de sa politique extérieure dément déjà, à priori, le tableau de pacification générale que Kautsky nous trace pour l’avoir observé de la portière de son wagon, entre Batoum et Tiflis. La liaison entre la politique extérieure et la politique intérieure devait se manifester en Géorgie avec d’autant plus de force que ce pays était né par voie de bourgeonnement, en deux étapes, de sorte que des questions qui, la veille encore, étaient pour lui des questions intérieures, devenaient le lendemain des questions extérieures. En outre, les mencheviks, sous prétexte de résoudre leurs problèmes extérieurs, avaient fait appel aux troupes étrangères — d’abord aux troupes allemandes, ensuite aux troupes anglaises — et, de nouveau, l’on peut dire déjà, à priori, que le général von Kress et le général Walker n’ont pas joué un rôle peu important dans la vie intérieure du pays.
Comme, d’après Kautsky, dont la banalité devient parfois paradoxale, les généraux des Hohenzollern remplissaient en Géorgie les hautes fonctions d’« organisateurs des forces productives » ( p. 51), sans porter atteinte au mécanisme délicat de la démocratie, il nous semble opportun de rapporter ici l’apostrophe menaçante de von Kress, relative à l’arrestation d’un groupe de nobles réactionnaires qui étaient en train d’organiser des bandes de pogromistes : « Le Gouvernement n’a pas le droit — enseignait von Kress au ministre Ramichvili — de considérer la politique d’un parti ou d’un groupe de citoyens comme suspecte par le fait seul qu’elle est dirigée contre le régime actuel. Tant que cette politique n’est pas dirigée contre l’existence même de l’État, l’on ne saurait dire qu’on soit en présence d’un crime de haute trahison. » Répondant à ces enseignements classiques, Ramichvili, entre autres, déclarait respectueusement : « J’ai proposé aux militants de cette union (de seigneurs terriens) de me présenter un projet d’amélioration de la situation des ci-devant nobles, ce que l’on est en train de faire. » Qui joue ici le meilleur rôle : l’organisateur des forces productrices, von Kress, ou le démocrate Ramichvili ? Il serait difficile de le dire. Nous avons déjà dit que les officiers anglais s’immisçaient dans la vie intérieure de la Géorgie avec une insolence encore plus grande que les officiers allemands. Toutefois, abstraction faite de la brutalité et de l’excès de franchise propres aux militaires, l’on voit que l’immixtion aussi bien des Allemands que des Anglais suivait la même ligne de conservatisme politique et social que suivaient les mencheviks depuis le début de la révolution.
La principale leçon tirée par Tsérételli de l’expérience de la révolution russe était que « la timidité et le manque de fermeté dont avait fait preuve la démocratie dans sa lutte contre l’anarchie » avaient perdu la démocratie, la révolution et le pays ; et, en sa qualité de principal inspirateur de la politique du Gouvernement, il exigeait que le Seïm transcaucasien « imposât au Gouvernement le devoir de lutter par les mesures les plus rigoureuses contre toute manifestation anarchique… » (18 mars 1918). Auparavant déjà, le 15 février, Jordania déclarait, à une séance du Seïm : « Dans notre paye, l’anarchie fait chaque jour des progrès… Parmi la classe ouvrière, l'état d’esprit est favorable au bolchevisme ; les ouvriers mencheviks eux-mêmes sont contaminés. »
Les premiers régiments nationaux géorgiens sont imbus du même esprit. Les soldats démobilisés apportent le virus révolutionnaire dans les villages. « Ce qui se passe actuellement dans nos villages — dit Jordania — n’est pas nouveau. Il en a été de même dans toutes (!) les révolutions, partout (!) les masses étaient hostiles à la démocratie. Il est temps que nous mettions fin au règne des illusions du parti social-démocrate sur la paysannerie. Il est temps de revenir à Marx et de monter fermement la garde pour la défense de la révolution et contre la réaction paysanne. » Cette référence à Marx témoigne d’une niaiserie doublée de charlatanisme. Pendant la période menchevique dont nous parlons, les paysans transcaucasiens s’insurgeaient, non pas contre la révolution démocratique, mais bien contre sa lenteur, contre son indécision et contre sa pusillanimité, surtout dans la question agraire. Ce n’est qu’après la victoire effective de la révolution agraire-démocratique que le terrain est déblayé pour les actions contre-révolutionnaires des paysans soulevés contre les exigences matérielles de la ville, contre les tendances socialistes de la politique économique et, finalement, contre la dictature du parti de la classe ouvrière. Si, dans la première période de la révolution, la force motrice des insurrections agraires est fournie par les couches inférieures de la population des campagnes, par les éléments les plus opprimés et les plus pauvres, dans la deuxième période, par contre, le rôle directeur, dans les soulèvements paysans, passe à la couche supérieure de la population des campagnes, aux éléments les plus riches, aux gros bonnets. Mais il est superflu de démontrer que les mencheviks géorgiens comprennent aussi peu l’A B C révolutionnaire du marxisme que leurs confrères non géorgiens. Il nous suffit d’enregistrer l’aveu suivant lequel les masses paysannes, qui forment l’immense majorité de la population, agissaient en bolcheviks contre la « démocratie » des mencheviks. Fidèle au programme fixé par le Seïm, le Gouvernement géorgien, appuyé sur la démocratie petite bourgeoise des villes et sur les couches supérieures de la classe ouvrière, très peu nombreuse d’ailleurs, menait une lutte sans merci contre les masses ouvrières contaminées par le bolchevisme.
Toute l’histoire de la Géorgie menchevique n’est qu’une longue suite d’insurrections paysannes. Elles éclatent littéralement dans tous les coins de ce petit pays et revêtent souvent un caractère d’acharnement extrême. Dans certains districts, le pouvoir soviétique se maintient pendant des mois. On liquide les insurrections par des expéditions spéciales qui se terminent par des exécutions sommaires, ordonnées par des tribunaux militaires composés d’officiers et de hobereaux.
Pour se faire une idée de la façon dont le Gouvernement géorgien venait à bout des paysans révolutionnaires, le mieux est de prendre le rapport des mencheviks abkhasiens sur l’action du détachement Mazniev en Abkhasie :
« Par sa cruauté, par sa barbarie — dit le rapport présenté au Gouvernement géorgien — ce détachement a surpassé les atrocités du général tsariste Alikhanov, de triste mémoire. Ainsi les cosaques de ce détachement faisaient irruption dans les paisibles villages abkhasiens, s’emparant de tout ce qui avait quelques valeur et violant les femmes. Une autre fraction de ce détachement s’occupait, sous la surveillance directe de M. Toukbaréli, à détruire, en y fêtant des bombes, les maisons appartenant aux personnes qui avaient été l’objet d’une dénonciation. Des actes de violence analogues ont été accomplis dans le district de Goudaout. Le chef du détachement géorgien, le lieutenant Koupounia, ex-inspecteur de police à Poti, fit coucher sous le feu des mitrailleuses les membres de l’Assemblée du village d’Asti ; puis, marchant sur le dos de ses victimes, il les frappa à coups redoublés du plat de son sabre. Ensuite, il ordonna à ces malheureux de s’assembler en un tas, et, poussant son cheval à toute allure, s’enfonça dans la foule en distribuant à droite et à gauche de grands coups de fouet. Les membres de l’ex-Conseïl du Peuple abkhasien, Tsoukouïa et Aboukhava, qui étaient venus protester contre une telle atrocité, ont été arrêtés et enfermés dans un hangar… Le suppléant du commissaire du district de Goudaout, le lieutenant Grigoriadi, faisait donner la bastonnade aux membres des assemblées rurales et nommait à son gré les commissaires ruraux, qu’ils choisissait parmi les anciens fonctionnaires tsaristes les plus détestés du peuple. »
N’est-il pas évident que les rapports entre les mencheviks et les paysans, comme le dit Kautsky, ont toujours été « les meilleurs du monde » ?… L’une des conséquences de la répression abkhasienne fut la sortie de presque tous les mencheviks abkhasiens du sein de la fraction social-démocrate (Tarnova, Bazba, Tchoukbar, Kobakhia, Tsvichba, Bartsitse et Dsoukouïa).
Dans l’Ossétie insurgée, Djoughéli n’agit pas mieux. Comme nous nous assignons la tâche, pour des raisons pédagogiques, de caractériser la politique des mencheviks géorgiens dans la mesure du possible au moyen de leurs propres déclarations et documents, il nous faut ici, malgré notre dégoût, donner quelques citations d’un livre de Valiko Djoughéli, l’ex-chef de la Garde Populaire, le menchevik « chevaleresque » dont nous avons déjà parlé. Ces citations auront trait aux faits et gestes de Djoughéli lui-même lors de la répression de l’insurrection des paysans ossètes.
« L’ennemi fuit partout, en désordre, presque sans résistance. Il faut châtier cruellement ces traîtres. »
Le même jour, il fait dans son journal (le livre est écrit sous forme d’un journal) la relation suivante :
« C’est la nuit. De toutes parts on voit des feux. Ce sont les maisons des insurgés qui brûlent. Mais j’y suis déjà habitué, et ce spectacle ne me trouble presque pas. »
Le jour suivant nous lisons :
«De tous côtés, autour de nous, brûlent les villages ossètes… Pour servir les intérêts de la classe ouvrière en lutte, les intérêts du socialisme qui vient, nous SERONS CRUELS. Oui, nous le serons. C’est en toute sérénité, la conscience calme, que je regarde les ruines et, au-dessus, les colonnes de fumée… Je suis tout à fait calme… oui, je suis calme. »
Le matin du jour suivant, Djoughéli écrit :
« Des flammes… Des maisons brûlent… Par le fer et par le feu… »
Le même jour, quelques heures plus tard, il écrit encore :
« Et les feux flambent, flambent… »
Le soir du même jour, il continue :
« Maintenant, les flammes sont partout… Elles flambent, elles flambent… Flammes sinistres… Une terrible, cruelle et féerique beauté… Et, jetant un coup d’œil circulaire sur ces flammes éclatantes dans la nuit, un vieux camarade me dit tristement : « Je commence à comprendre Néron et le grand incendie de Rome. »
«Et les feux flambent, flambent de tous côtés… »
Ce répugnant cabotinage fortifie en tout cas notre opinion sur les rapports entre les mencheviks et les paysans géorgiens : ces rapports n’ont cessé d’être « les meilleurs du monde ».
Après l’évacuation de l’Adjar (district de Batoum) par les Anglais, en 1920, le Gouvernement géorgien fut obligé, pour prendre possession de la région, de recourir à l’artillerie. En un mot, l’histrionisme néronien de Djoughéli pouvait trouver à s’exercer sur tous les points du territoire géorgien.[7]
A l’exemple de Jordania, le ministre de l’Intérieur, Ramichvili ( qui s’occupait, comme nous l’avons vu, d’améliorer la situation des ci-devant nobles), avait, lui aussi, recours à Marx pour justifier la terreur blanche exercée contre les paysans insurgés.
Toutefois, il est certain que, malgré la terreur blanche déguisée sous les fleurs de la rhétorique, la dictature menchevique eût été balayée comme un fétu de paille sans la présence dans le pays des troupes étrangères. Si les mencheviks se sont maintenus au pouvoir à cette époque, ils le doivent, non à l’Allemand Marx, mais à l’Allemand von Kress.
Mais ce qui est d’une ineptie flagrante, ce sont les affirmations de Kautsky sur la «liberté absolue d’action du parti communiste géorgien ». Il aurait pu se contenter de dire : une certaine liberté. Mais nous connaissons déjà la manière de Kautsky : s’il parle de neutralité, ce ne peut être que la neutralité « stricte » ; la liberté, pour lui, est « absolue », et les rapports ne sont pas simplement de bons rapports, mais « les meilleurs du monde ».
Ce qui frappe avant tout, c’est que ni Kautsky, ni Vandervelde, ni Mrs. Snowden elle-même, ni les diplomates étrangers, ni les journalistes de la presse bourgeoise, ni le Times, fidèle gardien de la liberté, ni l’honnête Temps, ni, en un mot, aucun de ceux qui ont donné leur bénédiction à la Géorgie démocratique, n’aient remarqué dans cette Géorgie… la Police Spéciale. Et cependant elle existait, la Police Spéciale, ne vous en déplaise ; c’était la Tchéka menchevique. Cette Police Spéciale s’emparait de tous ceux qui agissaient contre la démocratie menchevique, les arrêtait, les fusillait. Cette Police Spéciale ne différait en rien, dans ses méthodes terroristes, de la Tchéka de la Russie Soviétique, en rien, excepté dans ses buts. La Tchéka protégeait la dictature socialiste contre les agents du Capital, tandis que la Police Spéciale protégeait un régime bourgeois contre « l’anarchie » bolchevique. Mais c’est précisément pour cela que les honorables citoyens qui maudissaient la Tchéka ne remarquaient pas du tout la Police Spéciale géorgienne ! En revanche, les bolcheviks géorgiens, eux, ne pouvaient pas ne pas la remarquer, puisque c’était pour eux surtout qu’elle existait. Est-il nécessaire de faire ici le martyrologe du communisme géorgien ? Arrestations, déportations, extraditions, grèves de la faim, exécutions capitales… Est-ce bien nécessaire ? Ne suffit-il pas de rappeler le rapport respectueusement présenté par Guéguetchkori à Dénikine : « En ce qui concerne l’attitude envers les bolcheviks, je puis déclarer que, chez nous, la lutte contre le bolchevisme est IMPITOYABLE. Nous employons tous les moyens pour RÉPRIMER le bolchevisme… et de cela nous avons déjà donné nombre de preuves éloquentes. » Cette citation mériterait d’être inscrite sur le bonnet de nuit de Kautsky, si déjà il n’était en tous sens couvert d’inscriptions peu flatteuses. Là où Guéguetchkori dit : nous les réprimons par tous les moyens, nous les étranglons impitoyablement, Kautsky explique : liberté absolue. Ne serait-il pas temps Je soumettre Kautsky lui-même à une bonne petite tutelle véritablement démocratique ?
Dès le 8 février 1918, tous les journaux bolcheviks étaient interdits en Géorgie. A cette époque, la presse menchevique continuait à paraître légalement en Russie soviétique. Le 10 février eut lieu la fusillade dirigée contre un meeting pacifique qui se tenait dans le jardin Alexandrovsky, à Tiflis, le jour de l’inauguration du Seïm transcaucasien. Le 15 février, à une séance du Seïm, Jordania s’élevait contre l’esprit bolchevique qui régnait parmi les masses populaires et même parmi les ouvriers mencheviks. Enfin, Tsérételli, qui, avec Kérensky, accusait notre parti de crime de haute trahison, déplorait au Seïm, en mars, la « timidité » et les « hésitations » du gouvernement de Kérensky dans sa lutte contre les bolcheviks. Comme en Finlande, dans les pays baltiques, et en Ukraine, les troupes allemandes furent appelées en Géorgie pour lutter contre les bolcheviks. Au représentant américain qui lui avait posé une question sur les bolcheviks, Topouridzé, le représentant diplomatique de la Géorgie, répondit: « Nous en sommes venus à bout, nous les avons écrasés. Ce qui le prouve, c’est que de tous les pays qui composaient l’ancienne Russie, la Géorgie est le seul où le bolchevisme n’existe pas. » Topouridzé n’est pas moins catégorique en ce qui concerne l’avenir : « Notre République contribuera de toutes ses forces et par tous les moyens à aider les puissances de l’Entente dans leur lutte contre les bolcheviks. » Le chef des troupes britanniques de la Transcaucasie occidentale, le général Forestier Walker, expliqua à Jordania, le 4 janvier 1919, oralement et par écrit, que l’ennemi de l’Entente au Caucase était « le bolchevisme, que les grandes puissances avaient décidé d’extirper toujours et partout où U apparaîtrait ». A propos de l’instruction reçue de Walker, Jordania déclara deux semaines après au général anglais Milne : « Le général Walker… a été le premier à comprendre la situation réelle de notre pays. » Le général Milne lui-même résuma de la façon suivante le pacte conclu entre lui et Jordania : « Nos ennemis communs sont les Allemands et les bolcheviks. » Tout cela, dans son ensemble, créait évidemment les conditions les plus favorables pour la « liberté d’action absolue » des bolcheviks.
Le 18 février 1919, Walker donne l’ordre suivant (N® 99/6) au Gouvernement géorgien: «Tous les bolcheviks qui entreront en Géorgie doivent être incarcérés dans le Mtskhète (prison de Tiflis) et gardés à vue.» Il s’agit ici des bolcheviks qui fuyaient Dénikine. Mais, dès le 26 février, Walker écrit (N® 99/9) : « A la suite de la conversation que j’ai eue avec Son Excellence M. Jordania, le 20 de ce mois, j’en suis arrivé à la conclusion qu’il fallait à tout prix empêcher à l’avenir l’entrée des bolcheviks en Géorgie par la voie des chemins de fer géorgiens. » Les réfugiés bolcheviks que l’on enfermait dans le Mtskhète avaient au moins la vie sauve pour un certain temps. Walker « en arrive à la conclusion » que le mieux était de leur barrer la seule voie de salut et de les rejeter ainsi dans les mains des bourreaux de Dénikine. Si, entre ses campagnes contre les cruautés du Gouvernement soviétique et ses exercices religieux, Arthur Henderson arrivait à trouver un moment de loisir, il devrait bien s’entretenir à ce sujet avec Forestier Walker.
Leurs Excellences ne se bornèrent pas à des pourparlers et à des échanges de missives. Dès le 8 avril, 42 personnes, parmi lesquelles les commissaires soviétiques de la République de Térek, leurs femmes et leurs enfants, des soldats de l’Armée Rouge et d’autres réfugiés, étaient arrêtés par un poste géorgien près de la forteresse de Darial et, après des insultes, des violences et des voies de fait, étaient, par ordre du colonel Tsérételli, chassés sur le territoire de Dénikine. Jordania essaya d’expliquer cet innocent épisode en en rejetant la responsabilité exclusivement sur le colonel Tsérételli ; mais ce dernier ne faisait que remplir la convention secrète conclue entre Jordania et Walker. Il est vrai que le document N° 99/9 ne prévoit pas les coups de crosse et de bâton à la poitrine et à la tête. Mais, comment faire autrement pour chasser des gens exténués, affolés de terreur, qui cherchent à se sauver d’une mort certaine ? Le colonel Tsérételli, comme on le voit, s’était on ne peut mieux assimilé les préceptes de son illustre homonyme, d’après lequel « la timidité et les hésitations de la démocratie » dans sa lutte contre le bolchevisme pouvaient causer la perte de "État et de la nation.
Ainsi donc, la République géorgienne fut dès le début basée sur la lutte contre le communisme. Les leaders du parti et les membres du gouvernement se donnaient pour but dans leur programme « la répression impitoyable » dirigée contre les bolcheviks. C’est à ce but qu’étaient adaptés les organes les plus importants de l’État : la Police Spéciale, la Garde Populaire et la Milice. Les officiers allemands et, plus tard, les officiers anglais, qui étaient les véritables maîtres de la Géorgie à cette époque, approuvaient entièrement sous ce rapport le programme social-démocrate. Les journaux communistes étaient interdits, les assemblées dispersées à coups de fusil, les villages occupés par les bolcheviks, incendiés. La Police Spéciale passait les chefs bolcheviks par les armes, la prison de Mtskhète regorgeait de communistes, les réfugiés bolcheviks étaient remis entre les mains de Dénikine. Dans le courant du seul mois d’octobre 1919, d’après la déclaration du ministre de l’Intérieur, plus de trente communistes furent fusillés en Géorgie. A part cela, comme l’affirme l’optimisme béat de Kautsky, le Parti communiste jouissait en Géorgie d’une « liberté d’action absolue ».
Il est vrai que, précisément, au moment où Kautsky se trouvait à Tiflis, les communistes géorgiens possédaient leurs éditions légales et jouissaient d’une certaine liberté, mais d’une liberté qui était loin d’être « absolue »… Mais il faut se hâter d’ajouter que ce régime provisoire avait été institué après la débâcle de Dénikine, sous la pression de l’ultimatum soviétique dont l’aboutissement fut le traité de paix conclu le 3 mai 1920 entre la Russie des Soviets et la Géorgie. Entre le mois de février 1918 et le mois de juin 1920, le Parti Communiste géorgien n’avait cessé d’être réduit à l’action clandestine… Les Soviets sont donc intervenus en 1920 dans les affaires intérieures d’une « démocratie » et, qui plus est, d’une démocratie « neutre » !… Hélas ! Hélas ! il est impossible de le nier. Le général von Kress exigeait pour les nobles géorgiens la liberté d’action contre-révolutionnaire. Le général Walker exigeait que les communistes fussent jetés dans le Mtskhète et renvoyés à coups de crosse à Dénikine. Et nous, après avoir mis en déroute Dénikine et l’avoir poursuivi jusqu’aux frontières de la Géorgie, nous exigeâmes pour les communistes la liberté d’action dans la mesure où elle n’aurait pas pour but une insurrection armée. Le monde est loin d’être parfait, M. Henderson ! Le gouvernement menchevique se vit obligé de faire droit à notre demande et de libérer d’un seul coup (d’après les données officielles), près de 900 bolcheviks.[8]
Comme on le voit il n’y avait pas tant que cela de bolcheviks emprisonnés. Mais il faut tenir compte du chiffre de la population. Si, pour être équitables (car nos cœurs non plus ne sont pas insensibles à l’équité, ô Mrs. Snowden ! ) nous prenons comme base du calcul la Géorgie, où il y avait 900 détenus pour 2 millions et demi d’habitants, il résulte que nous avons le droit d’incarcérer dans les prisons des républiques soviétiques près de 45.000 mencheviks. Or, aux périodes les plus pénibles et les plus aiguës de la révolution — dont les mencheviks profitaient toujours pour intensifier leur propagande hostile — nous ne sommes jamais arrivés même au dixième de ce chiffre imposant. Et, comme sur le territoire soviétique on serait bien en peine de rassembler 45.000 mencheviks, nous pouvons nous porter garants de ce que jamais nous n’atteindrons la norme de répression instituée par la démocratie Jordania-Tsérételli et approuvée par les lumières de la IIe Internationale.
Ainsi, au mois de mai, sous le régime de la guerre civile, nous obligeâmes le gouvernement géorgien à « légaliser » le parti communiste. Ceux qui avaient été fusillés, naturellement, ne ressuscitèrent pas, mais ceux qui étaient en prison furent relâchés. Si donc la démocratie revêtit des formes tant soit peu démocratiques, ce ne fut, comme nous le voyons, que sous le poing de la dictature prolétarienne. Le poing révolutionnaire, instrument de démocratisme, quel excellent thème pour votre prochain prêche dominical, M. Henderson ! — Est-ce à dire qu’à partir du milieu de l’année 1920, la politique géorgienne se modifia et tendit à un rapprochement avec les bolcheviks ? Pas le moins du monde. Le gouvernement menchevik traversa, au printemps 1920, une période aiguë d’épouvante et capitula. Mais lorsqu’il se fut convaincu, non sans stupéfaction, que le poing au-dessus de lui ne s’abattait pas, il se dit qu’il s’était exagéré le danger et commença à faire machine en arrière sur toute la ligne.
Les répressions contre les communistes reprirent. Dans une série de notes d’une monotonie fatigante, notre représentant diplomatique ne cessa de protester contre l’interdiction des journaux, contre les arrestations, la mainmise sur les biens du parti, etc. Mais ces protestations ne produisaient plus d’effet : le gouvernement géorgien avait pris le mors au dents ; il collaborait avec Wrangel, comptait sur la Pologne, et, ce faisant, hâtait le dénouement…
Résumons : En quoi exactement la « démocratie » menchevique différait-elle de la dictature bolchevique ? En premier lieu, en ce que le régime terroriste menchevique, qui était un pastiche des méthodes employées par les bolcheviks, avait pour but de protéger les piliers de la propriété privée et l’alliance avec l’impérialisme. La dictature soviétique, elle, était et est encore une lutte organisée pour la reconstruction socialiste de la société en union avec le prolétariat révolutionnaire. En second lieu, en ce que la dictature soviétique des bolcheviks puise sa justification dans sa mission historique et dans les conditions de sa réalisation et agit ouvertement. Le régime menchevique, lui, avec son terrorisme et sa démocratie, est le bâtard impuissant de la poltronnerie et du mensonge.
[7] Nous n’énumérerons pas ici les insurrections paysannes en Géorgie. L’article du camarade Mikha Tskhakaïa paru dans le N° 18 de l’Internationale Communiste donne un tableau succinct du mouvement.
[8] Cf. la note du ministre des Affaires Etrangères géorgien en date du 30 juin 1920 (N° 5171).