|
|
|
|
1961 |
" A ceux qui crient à « l'Espagne éternelle » devant les milices de la République avec leurs chefs ouvriers élus et leurs titres ronflants, il faut rappeler la Commune de Paris et ses Fédérés, ses officiers-militants élus, ses « Turcos de la Commune », ses « Vengeurs de Flourens », ses « Lascars ». " |
On a pu assister, dans le courant de l'année 37, à une évolution politique parallèle dans les deux camps. A Valence comme à Burgos, le pouvoir fort l'a emporté sur les éléments de dispersion, l'autorité régulière sur les partisans du « mouvement ». L'évolution ainsi amorcée semble irréversible. On ne peut envisager un brutal renversement politique en zone nationaliste après la mise au pas des Camisas viejas pas plus qu'en Espagne républicaine après les Journées de mal. On en est ainsi revenu aux conditions d'une guerre de type traditionnel. L'examen des événements survenus sur le plan militaire révèle cependant une évolution défavorable au gouvernement de Valence.
Il est incontestable que la situation militaire, à la fin de l'année 37, est très inquiétante pour les républicains. L'impression qui domine, après la chute du Nord, est celle d'une totale impuissance. Toutes les tentatives pour limiter la portée des succès nationalistes ont en définitive échoué. Il y a eu, sans doute, un effort d'organisation; Rojo dénombre cinq corps d'armée instruits, préparés à la guerre. Mais leur équipement reste insuffisant, et, surtout, ils manquent de confiance en leurs moyens. La fin des combats dans les Asturies va d'autre part libérer des troupes nationalistes nombreuses et bien entraînées.
Ces renforts vont profondément modifier l'équilibre des forces dans la partie du front où ils seront employés. Franco dispose en effet maintenant de près de 600 000 hommes, dont le tiers environ peut être gardé en réserve. Les forces navarraises, qui seules ont conservé jusqu'alors leur répartition originale en brigades, ont été réorganisées en divisions à partir du 9 novembre.
Des trois secteurs que les nationalistes peuvent choisir pour lancer une nouvelle offensive, deux sont tenus par des effectifs peu importants, celui du Sud, que dirige toujours Queipo, et celui du Nord, commandé par Davila. La concentration de troupes la plus importante se trouve autour de Madrid. Il apparaît donc à l'état-major nationaliste qu'un succès, pour être définitif, doit être remporté dans ce secteur, de très loin le plus important. Pour la première fois depuis Guadalajara, Franco s'estime en mesure de frapper un grand coup en direction de la capitale. Il n'est pas question pourtant d'une offensive frontale qui risquerait d'aboutir à un échec devant une défense bien organisée, et entraînerait, en tout cas, des pertes énormes. Mieux vaut donc revenir au principe d'une action tournante; l'offensive doit être aussi large que possible pour utiliser au maximum la supériorité numérique et matérielle dont disposent les nationalistes. Il est prévu une « manœuvre convergente » sur Alcala de Henarès. Le corps d'armée marocain, selon Diaz de Villegas, descendrait le long du Henarès, le C.T.V. progresserait le long du Tajuna et le corps d'armée de Castille le long du Tage. Cette vaste manœuvre suppose naturellement une assez longue préparation; de plus, une concentration de troupes si importante a peu de chances de passer inaperçue ...
L'état-major républicain a de son côté conscience que, s'il laisse une fois de plus les nationalistes prendre l'initiative des opérations, il risque la défaite. Le gouvernement républicain a absolument besoin de remporter un succès qui relève le moral de ses partisans, et justifie sa propre action par une démonstration d'efficacité. La fin de l'année 37 a vu la consolidation politique de Negrín : ses amis se sont emparés de la direction de l'U.G.T. Il transfère ministères et administrations centrales de Valence à Barcelone. Le président donne les raisons de ce transfert, inimaginable au début de l'année: « Il s'agit d'une vieille idée du gouvernement précédent. La résidence du gouvernement à Valence avait été déterminée par la nécessité d'organiser le ravitaillement et les opérations militaires des fronts du Centre et de l'Est. .. Le gouvernement a la conviction que la région du Levant conservera son enthousiasme. Les circonstances d'ordre économique et stratégique réclament depuis le premier jour du Movimiento le siège du gouvernement à Barcelone. » Les motifs invoqués ne sont pas nouveaux: si le transfert ne s'est pas fait plus tôt, c'est que la force de la C.N.T. et celle des autonomistes rendaient difficile l'installation à Barcelone du gouvernement central. Aujourd'hui, Negrín peut, dans son discours, parler de « relations cordiales avec la Généralité ». En ce sens, on peut parler d'un renforcement de l'unité dans le camp républicain. L'unité politique, pourtant, ne saurait vraiment se forger que par la victoire militaire.
L'état-major républicain se trouve donc contraint à l'offensive. Le 8 décembre, le Conseil supérieur de la Guerre approuve le choix de Teruel comme objectif. Les positions semblent favorables à une attaque. Le front dessine une large boucle qui s'avance en pointe autour de la ville, formant un saillant dans les positions républicaines. Il suit, au nord, la zone montagneuse qui domine l'Alfambra et fait un brusque coude pour s'orienter dans la direction sud-est-nord-ouest entre Teruel et Albarracin, au nord des hauts reliefs des Montes Universales. Les gouvernementaux occupent donc des positions qui dominent la ville de part et d'autre. De plus, contre les forces médiocres dont les nationalistes disposent ici comme sur tout le front septentrional - 2 500 hommes pour défendre Teruel au début de la bataille - les républicains vont engager des forces considérables, 40 000 hommes, sur un secteur d'attaque d'étendue très restreinte. Les trois corps d'armée qui constituent l'armée de manœuvre seront appuyés par les troupes du Levant qui tenaient le secteur jusque-là. Le 22° Corps, sous Ibarrola, doit attaquer par le nord, le 20°, sous Menendez, au sud-est, le 18°, sous Heredia, au sud. Le but premier de la manœuvre est d'établir une jonction, au-delà de Teruel, entre les troupes du 18° et du 22° corps, isolant ainsi les défenseurs de la ville et réduisant du même coup le saillant.
L'offensive commence le 15 décembre. Pendant une semaine, du 15 au 22, elle remporte d'importants succès. Dès les premières heures, il est clair que la manœuvre d'enveloppement est en train de réussir: Campillo, qui a résisté, et San-Blas, tombent. Il reste néanmoins d'importants noyaux de résistance à l'arrière qu'il faudra réduire les uns après les autres. Le 18 tombe la Muela de Teruel, qui domine la ville au sud-ouest. Ses défenseurs, reculant en combattant se sont réfugiés dans la ville, où deux divisions républicaines entrent le 22. Les nationalistes, sous le commandement du colonel Rey d'Harcourt, se sont retranchés dans les bâtiments du gouvernement civil, de la Banque d'Espagne, de l'hôpital, du séminaire et des couvents de Santa-Clara et Santa-Teresa. Deux fronts s'organisent ainsi : un front extérieur, à peu près régularisé, à l'ouest d'une ligne qui part du Muleton vers San Bias et Rubiales, et un autre à l'intérieur de la cité, pour réduire les quelques milliers d'hommes qui s'y sont réfugiés. Les forces républicaines ne sont pas suffisamment nombreuses pour mener en même temps la conquête de la ville et la poursuite de l'attaque en profondeur, et, du 23 au 28 décembre, se produit une période de stabilisation.
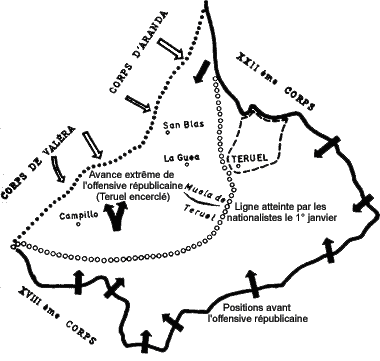
Plan de la bataille de Teruel (décembre 37-janvier 38)
Pendant ce temps, les franquistes amènent des renforts, qui leur permettront de tenir et même de contre-attaquer. Sans doute ont-ils dû choisir entre défendre Teruel et préparer une attaque sur Madrid. Franco a personnellement décidé d'accepter la bataille sur le terrain choisi par l'adversaire [1]. Il a commencé par envoyer au secours du secteur menacé des troupes retirées du front d'Aragon, d'où elles peuvent arriver rapidement: elles sont là dès le 17 décembre. Puis il a fait converger vers la ligne de bataille les divisions du corps de Galice que commande Aranda, par la route de Saragosse, et celles du corps de Castille, sous Varela, par la route de Molina d'Aragon. L'état-major nationaliste dispose alors de dix divisions. Davila en reçoit la direction, avec mission de délivrer Teruel. En soi, cet afflux de troupes constitue déjà un succès pour les républicains : plus heureux qu'à Brunete, ils ont contraint les nationalistes à modifier leurs plans et à renoncer à la grande offensive contre Madrid, dont il ne sera d'ailleurs jamais plus question jusqu'à la fin de la guerre. La déception a été grande chez les alliés de Franco, témoin cette note de Schwendemann: « L'espoir, avant les événements de Teruel, de voir Franco terminer la guerre par une offensive de grand style, n'était pas fondé » [2]. Dès le 20 décembre, le comte Ciano s'interroge : « L'offensive contre Guadalajara est renvoyée sine die en raison des hésitations du commandement nationaliste et de l'offensive préventive des Rouges. »
L'échec de la contre-offensive nationaliste va justifier les craintes des généraux italiens. Malgré l'accumulation du matériel, la supériorité de l'aviation, l'énorme densité de l'artillerie[3], la violence des assauts enfin, une partie seulement des objectifs sont atteints. Au début, on a obtenu quelques résultats: le 20° corps républicain a reculé en désordre. Les troupes d'Aranda ont progressé en direction de Teruel et repris la Muela; ils dominent la ville et sont à ce point certains de la prendre que la radio nationaliste annonce que c'est chose faite. Pourtant, début Janvier, une nouvelle ligne de front s'est dessinée: elle ne subira pratiquement aucun changement pendant un mois.
Comment expliquer cet échec nationaliste? D'abord par l'ampleur et l'acharnement de la bataille. Pour tenir, de part et d'autre, on a amené des troupes et des moyens nouveaux. On peut admettre comme vraisemblable le Chiffre de 180 000 combattants qui a été avancé: c'est, au cours de la guerre, la plus forte concentration d'hommes sur un espace aussi réduit. Mais la bataille est aussi une bataille de matériel: l'importance de l'artillerie engagée est telle que les fantassins doivent se terrer et que les renforts n'arrivent plus que de nuit. Les conditions du combat sont devenues singulièrement difficiles, d'autant plus que, dans cette région de l'intérieur où le climat est dur, le froid a fait son apparition avec une rigueur toute particulière : on doit relever les soldats tous les quarts d'heure, et, par moins 20°, les hommes retranchés doivent d'abord se protéger du froid, de la neige et du vent. Sur la neige, tout devient cible et les attaques sont plus rares: les convois de nuit eux-mêmes arrivent difficilement avec le verglas: « Les fossés sont jonchés de carcasses de fer»[4]. La supériorité aérienne des nationalistes ne peut être exploitée à fond, car le temps ne permet pas toujours aux avions de sortir. Ansaldo parlera « des matins sur le nouvel aérodrome de Burgos » où il faut « débarrasser le fuselage d'une épaisse couche de glace ». D'ailleurs, les républicains ont eux aussi fait un effort considérable, et la faible étendue du front permet une utilisation efficace de la D.C.A. [5].
Malgré ces conditions difficiles, les nationalistes continuent leurs attaques dans la première semaine de janvier. Le 7 janvier, enfin, le calme revient. La poursuite de l'offensive n'aurait en effet plus de sens, car les défenseurs de la ville ont capitulé : Teruel est tout entière aux mains des républicains. La lutte a été longue et dure; les uns après les autres, les édifices où s'abritaient les franquistes ont été détruits : le séminaire a brûlé et les gouvernementaux ont fait sauter la Banque d'Espagne. L'espoir de faire de Teruel un nouvel Alcazar se révèle vain. Les défenseurs étant coupés les uns des autres, le couvent de Santa Clara ne se rendra que le 8 - vingt-quatre heures après que Rey d'Harcourt ait capitulé avec 1 500 hommes. Un communiqué officiel annonce : « Teruel appartient entièrement à la République. » Ce n'est pourtant pas un succès extraordinaire: le centre de la ville est en ruines, et il faudra quinze jours pour éliminer tous les francs-tireurs. C'est que la défense a été courageuse, en dépit de ce que Queipo croit pouvoir affirmer à Radio-Séville, sur la « trahison d'une canaille » qui, seule, aurait permis la chute de la ville. Mais cette colère même indique bien l'importance de la prise de Teruel pour les républicains. C'est la première, ce sera la seule ville importante qu'ils auront pu reprendre au cours de la guerre. S'il est inexact de dire, comme Rojo, que «Teruel a changé la face de la guerre» [6], du moins peut-on admettre qu'elle a donné l'impression de l'avoir fait. A l'issue de cette terrible bataille, c'est l'armée républicaine qui fait figure de vainqueur. Après les décourageants communiqués qui ont annoncé successivement la perte de Bilbao, de Santander, de Gijón, enfin un communiqué d'espoir !
Mais cette victoire a des limites. La question a été posée [7] - comme pour tous les succès républicains - de savoir s'il aurait été possible de mieux exploiter le succès initial. La réponse est négative : les réserves manquaient. Les républicains sont, au total, moins nombreux que leurs adversaires alors que, pour compenser leur infériorité en armements et en matériel, il leur faudrait au moins la supériorité numérique en hommes. Ils n'y parviennent que pendant quelques jours, le temps pour l'adversaire d'amener des renforts. Dans ces conditions, c'est déjà un succès pour l'état-major républicain que d'avoir réussi à conserver les positions conquises. Mais c'est aussi pour cette raison que Franco ne peut rester sur une défaite dont il a de bonnes raisons de croire qu'elle n'est que provisoire. En effet, les chefs républicains ne peuvent pas oublier, dans l'euphorie du succès, que même ici, un jour, ils ont été au bord du désastre: le 29, leurs lignes ont été rompues. Ce jour-là, à Teruel, comme auparavant à Brunete, il s'est produit un moment de panique, sans qu'on puisse lui donner d'explication raisonnable. Il a fallu acheminer, en toute hâte, des renforts pour rétablir la ligne de bataille et empêcher la jonction des troupes d'Aranda avec les assiégés de la ville [8].
A partir du 15 janvier, le temps s'est radouci et la supériorité aérienne des nationalistes peut se manifester de nouveau. Aranda prépare une attaque, non contre Teruel, car la progression dans la plaine présente trop de risques, mais sur les positions qui la dominent, avant tout au nord. Ses hommes réussissent ainsi à s'emparer de postes d'observation importants, dont celui du Multon, ce qui rend aventurée la position des forces républicaines. Ils ont ainsi une base de départ pour les opérations qui vont maintenant Se déplacer vers le nord, autour de la rivière Alfambra.
Mais il faudra d'abord briser les nouvelles attaques républicaines qui vont durer cinq jours, du 25 au 30 janvier, et resteront infructueuses. Il faut ensuite concentrer à l'ouest de l'Alfambra des forces destinées à enfoncer le front républicain et à déloger les troupes qui tiennent de solides positions dans la Sierra Palomera : c'est de là qu'est partie l'offensive victorieuse de décembre. Mais le commandement nationaliste est plus ambitieux encore. Son plan consiste à reculer le front vers l'est, de façon à déborder Teruel et les positions républicaines vers le nord. Eventuellement, au cours des opérations, il envisage une manœuvre d'encerclement du 23° corps d'armée qui couvre ce secteur. L'attaque sera donc menée aux deux extrémités du dispositif nationaliste: au nord, sous le commandement de Yagüe, le corps d'armée marocain, appuyé sur les Navarrais, doit progresser en direction de Viver del Rio. Au sud, le corps de Galice, renforcé par la 150° division de Muñoz Grande, doit percer le front dans la zone montagneuse entre Teruel et Celados et traverser l'Alfambra. Le centre du dispositif est le moins garni, avec la l° division du colonel Monasterio.
La double attaque se produit le 5 février et permet d'obtenir un premier succès. Les troupes de Yagüe ont rompu le front et réussi à déborder les positions républicaines jusqu'à l'Alfambra. Au sud, cependant, la progression d'Aranda est plus lente. Sans doute la rivière est-elle atteinte et Celados occupé. Mais le danger immédiat sur Teruel entraîne un raidissement de la défense républicaine. La réapparition du mauvais temps va une fois de plus ralentir les combats et l'offensive s'arrête, vers le 15 février, gênée par le vent et la pluie. La manœuvre d'encerclement n'a pas réussi, mais les nationalistes ont largement amélioré leurs positions. Le front offre désormais une ligne presque continue entre Teruel et Belchite au sud de l'Ebre. Les républicains sont très éprouvés par la bataille d'usure qu'ils soutiennent depuis bientôt deux mois, et lorsque les nationalistes reprennent l'offensive, le 18, le dispositif de défense est tout de suite enfoncé. Teruel est largement débordé par les avant-gardes qui coupent, le 20, la route de Sagonte, à l'est. Pendant deux jours encore, on se battra dans Teruel. Mais le cœur n'y est plus. Le 22 février, les républicains ont complètement évacué la ville. La bataille est terminée.
Autant l'occupation de Teruel a un moment contribué à redonner confiance aux combattants républicains, autant sa perte peut être considérée comme un tournant très grave dans le cours de la guerre civile. Les deux partis se sont acharnés à se disputer des ruines; le coup de main réussi s'est transformé en une bataille longue, une bataille de destruction où la supériorité matérielle l'emportera en définitive. Teruel a peut-être été, comme le dit Rojo, la « révélation de la grandeur morale » du combattant espagnol. Mais le courage et la persévérance des hommes ne suffisent pas à eux seuls à donner la victoire: de cela aussi Teruel a donné la preuve. La fin de la bataille marque en réalité le début d'une phase nouvelle de la guerre. Jusque-là, un certain équilibre s'était manifesté sur le plan militaire. A Teruel, des masses d'hommes se sont affrontées pendant des mois sans parvenir à remporter de succès décisif, et, brusquement, les lignes républicaines cèdent et l'offensive nationaliste se développe avec une ampleur irrésistible: l'équilibre des forces est définitivement rompu.
Cependant, en zone républicaine, l'autorité du gouvernement Negrín semblait s'être constamment affermie depuis juillet 37. La C.N.T. ne songe pas à une opposition politique sérieuse. La direction de l'U.G.T. est solidement derrière Negrín. Mais le programme politique du gouvernement, reposant sur l'impératif de « vaincre Franco d'abord », lui fait une absolue nécessité de remporter des victoires militaires. Or la perte du Nord, qui suit de très près son accession au pouvoir, et qu'il ne parvient ni à empêcher, ni à retarder, porte un rude coup à son prestige. Le désastre d'Aragon l'atteindra plus encore. Désormais, crise militaire et crise politique se développent parallèlement, affaiblissant également l'Espagne républicaine.
Sans doute faut-il admettre que le gouvernement Negrín n'a guère eu le temps, avant les premiers combats d'envergure, de prendre en mains l'organisation de la guerre. Un gros effort a pourtant été fait sur le plan militaire au cours de l'année 37. La réorganisation, entamée au début de l'année, a permis d'entraîner et d'armer des troupes qui ont donné, à Teruel et à Belchite, des preuves de leur combativité. Mais les réserves ont toujours manqué et les meilleurs éléments, à peine formés, sont immédiatement utilisés. Les offensives de Brunete et Belchite ont été coûteuses en vies humaines. La bataille d'usure de Teruel a fatigué et éprouvé les hommes, obligés de combattre pendant de trop longs jours sans être relevés. Enfin le ralentissement des livraisons de matériel de guerre étranger pèse gravement sur l'équipement des troupes. L'Espagne républicaine souffre du blocus, interrompu seulement en septembre 37. Dès la fin de l'année, malgré les mesures prises par les puissances occidentales, c'est avec de gros risques que les navires doivent se rendre dans les ports gouvernementaux. La seule voie de passage reste la frontière française des Pyrénées, et cela explique le souci constant du gouvernement de ne jamais être coupé de la France. C'est un des arguments avancés par Negrín pour expliquer le transfert du gouvernement à Barcelone. C'est aussi celui qui décidera les ministres républicains à rester dans la capitale catalane lorsque le territoire de la République sera coupé en deux par l'offensive nationaliste.
Mais la Catalogne n'est protégée que par une faible partie des effectifs républicains. Au contraire, la bataille de Teruel a contraint les nationalistes à masser la majorité de leurs troupes de part et d'autre de la ville, et, plus au nord, du Maeztrazgo à l'Ebre. Si le plans du Caudillo ont été bouleversés, et s'il n'est plus question, pour emporter la décision, de lancer sur Madrid une grande offensive, en revanche, la concentration des troupes sur le front d'Aragon, après la victoire de Teruel, met à la disposition du commandement nationaliste une masse de manœuvre incontestablement supérieure : trois corps d'armée contre le seul 12° corps républicain.
Avec l'offensive d'Aragon surtout, la guerre va changer d'allure. C'est la fin de la guerre de position : la bataille de rupture est immédiatement suivie d'une offensive générale. Et, dans cette nouvelle guerre de mouvement, troupes motorisées et forces blindées, lancées massivement en avant, vont jouer un rôle déterminant.
L'attaque a commencé le 9 mars 1938. Le terrain est celui, largement ouvert, sur lequel s'est déroulé la bataille de Belchite, région propice à une offensive de grande envergure, puisqu'il ne présente, dans un large rayon, aucun obstacle véritable et se prête admirablement à l'utilisation des tanks, et aux vastes manœuvres. Franco y a concentré des effectifs considérables. Le corps de Galice, au sud, doit attaquer en direction de Montalban, le Corpo truppe volontarie dans la zone des Llanos vers Alcañiz. Le corps d'armée marocain, au nord, opère sur Belchite et a pour objectif la rive droite de l'Ebre, en direction de Caspe. Le but de l'offensive dirigée par Aranda est de briser la ligne tenue par le 12° corps d'armée républicain pour atteindre la Guadalupe sur une ligne Caspe-Alcañiz. Ainsi se formerait, dans le front républicain une immense poche rejetant au nord de l'Ebre l'armée de l'Est, menaçant de débordement sur leur flanc droit les forces concentrées autour de Teruel. L'occupation des positions visées au sud et au sud-est de Montalban permettrait en outre aux franquistes de contrôler les débouchés de la région montagneuse du Maeztrazgo : au-delà de la ligne Caspe-Alcañiz, l'état-major nationaliste vise en réalité la Méditerranée et cherche à couper en deux l'Espagne républicaine.
L'attaque nationaliste n'est pas, à proprement parler, une surprise, mais elle trouve les forces républicaines en pleine réorganisation. Le 18° corps, qui est en réserve, ne peut même pas intervenir: pour la première fois depuis le début de la guerre, on assiste à un véritable écroulement du front, sans aucune commune mesure avec les paniques locales qui avaient souvent marqué de telles opérations. Les colonnes motorisées italiennes et marocaines avancent sans rencontrer pratiquement de résistance. Les troupes républicaines les plus solides se replient au nord de l'Ebre. Les autres ne sont plus qu'une masse de fuyards sans aucun encadrement; mal équipées et mal armées, elles ne peuvent pas tenir face à une opération d'une telle envergure. Le 21° corps d'armée qui a, d'abord, contenu les Galiciens, doit se replier contre la menace au nord de son dispositif. Une vaste zone est désormais exposée, sans défense, à la progression de l'adversaire : « Le 15 mars, écrit Rojo, dans le vaste espace qui va de Caspe à Calanda, il n'y avait plus une seule unité organisée, il n'y avait plus de liaison entre les armées de l'Est et de manœuvre, et un front de soixante kilomètres était entièrement ouvert à l'invasion jusqu'à la côte.» En six jours, le C.T.V. franchit la moitié du chemin qui le sépare de la Méditerranée.
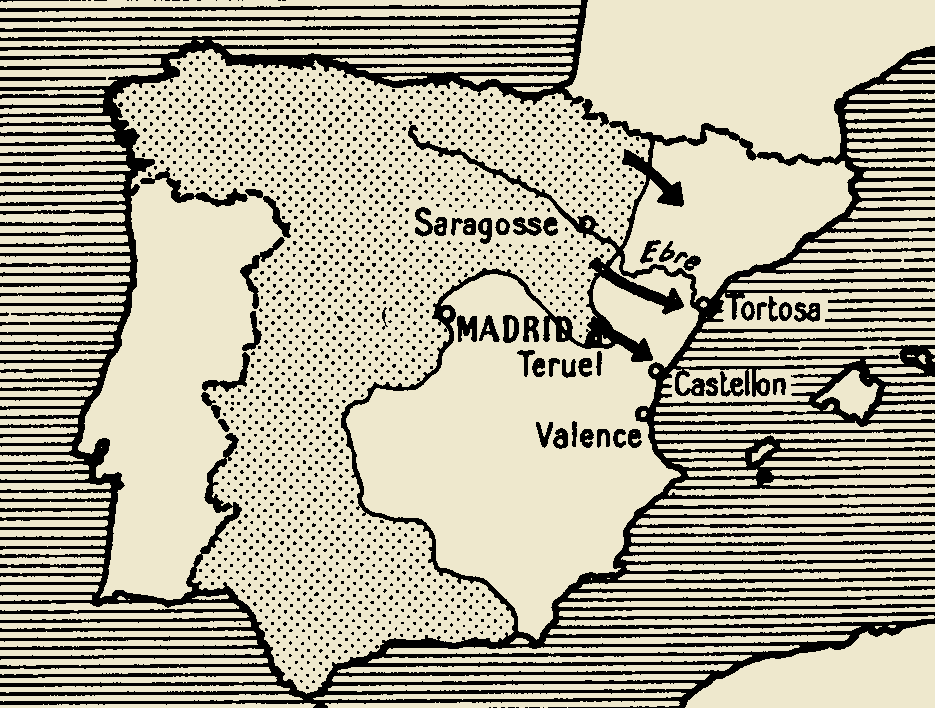
L'offensive d'Aragon (mars 1938)
Il est difficile, dans ces conditions, de comprendre l'interruption de cette offensive éclair qui se ralentit entre le 16 et le 21 mars. Les communiqués officiels et l'optimisme de Ciano peuvent seuls expliquer « l'arrêt sur les positions conquises » par la nécessité de « permettre aux nationalistes d'épauler les Italiens ». En réalité, les nationalistes ont été les premiers surpris par l'ampleur de leur succès. « Les troupes, note Ciano le 14 mars, avancent avec une vitesse inattendue. » Mais, après cinq jours d'une avance foudroyante, il faut ralentir l'allure des colonnes motorisées. Les réserves sont insuffisantes pour exploiter immédiatement les premiers succès et il faudra attendre l'arrivée des Navarrais pour repartir. L'état-major républicain en profite pour regrouper quelques unités qu'il utilise, dans des missions de sacrifice, à des actions de harcèlement et de retardement : il parvient, le 20 mars, à reconstituer un front, fragile sans doute, mais continu. Dans le bref délai que leur accorde la pause nationaliste, il appartient aux gouvernementaux d'amener le maximum de renforts pour « colmater la brèche » et, surtout, défendre la Catalogne. Prieto déclare en effet au Conseil des ministres : « Si les rebelles atteignent la Méditerranée, les quatre cinquièmes de l'armée se trouveront dans la zone méridionale. » Entre le 15 mars et le 15 avril, date ou les nationalistes atteignent la mer à Vinaroz, l'état-major de Barcelone essaye de faire passer le plus possible de troupes par la route côtière de Tortosa. C'est ce qui explique l'acharnement de la résistance républicaine, d'abord sur la ligne Caspe-Alcañiz, puis, après sa rupture, devant Tortosa. Mais, en définitive, cette résistance n'a été - et ne pouvait être - que sporadique.
En effet, la première offensive nationaliste a été très lourde de conséquences: la désorganisation qu'elle a provoquée ne peut être surmontée en quelques jours. La reprise de l'offensive ne le permettrait d'ailleurs pas. La confusion est telle chez les républicains qu'on ignore les positions exactes des franquistes. Deux officiers des brigades se font prendre à Gandesa dont ils ignoraient la chute. Les débris d'unités diverses affluent sur la rive droite de l'Ebre où arrivent aussi les renforts venus de la zone centrale. Pour la première fois peut-être, devant une débâcle d'une telle ampleur, certains envisagent la fin prochaine du conflit. Les officiers généraux doivent se rendre en première ligne pour essayer de reprendre les troupes en main et d'improviser tant bien que vaille une défense.
Mais c'est surtout la généralisation de l'offensive qui donne à la défaite d'Aragon son caractère désastreux. Après l'attaque de Caspe, six corps d'armée nationalistes ont engagés. Dans le Nord, il s'agit d'empêcher les 10° et 11° corps républicains disposés de l'Ebre aux Pyrénées de venir en aide aux forces dispersées et vaincues au sud du fleuve. Le succès nationaliste sera décidé par une attaque surprise du corps d'armée marocain, qui traverse brusquement le fleuve qu'il longeait jusqu'alors: les 10° et 11° corps républicains connaissent un sort semblable à celui du 12° quelques jours auparavant, sur un terrain pourtant moins favorable aux manœuvres d'ensemble. Là encore, la résistance est pratiquement nulle. La seule opposition sérieuse en dix jours est celle que les nationalistes rencontrent devant Lérida, qui tombe le 3 avril. Le front va se stabiliser dans ce secteur. Mais, entre-temps, l'offensive est devenue générale des deux côtés du fleuve, avec les corps d'armée d'Aragon, marocain et d'Urgel, récemment formé. Les républicains ne se reconstitueront que sur une ligne qui va de l'Ebre aux Pyrénées en passant par le Segre et le Noguera, défenses naturelles derrière lesquelles les débris des deux corps d'armée battus ont pu se replier, Rojo cite notamment la 43° division du colonel Beltran qui, isolée dès la rupture du front, mènera une bataille de retardement de trois mois en s'accrochant aux contreforts pyrénéens avant d'être internée en France où elle passe avec la plus grande partie de son matériel. Mais des résistances isolées de ce type ne pouvaient que retarder l'avance nationaliste sans l'arrêter, d'autant plus que Franco avait décidé de frapper au sud et de livrer la bataille dans le Levant, où les trois corps d'armée atteignent la Méditerranée. Au quartier général franquiste on se pose la question de savoir s'il convient de faire un nouvel effort contre la Catalogne que tiennent des troupes très éprouvées ou s'il faut rechercher l'écrasement de l'adversaire en attaquant l'armée de manœuvre républicaine dont les lignes se sont dangereusement étirées. C'est la deuxième solution qui est choisie.
C'est en réalité l'opération la plus difficile: la zone montagneuse du Maeztrazgo à la mer, les escarpements de la Sierra de Javalambre qui s'élèvent jusqu'à 1 500 et 2 000 mètres, et, à un moindre degré, la Sierra de Espadan, entre Castellon et Valence, facilitent singulièrement la défense. Les gouvernementaux, d'ailleurs, fortifient une ligne de Viver à Segorbe. Leurs troupes, ici, sont plus fraîches. Contre elles, et dans un espace beaucoup plus restreint, il faudra concentrer beaucoup plus d'hommes et de matériel que dans la première partie de l'offensive. Tandis que le corps d'armée marocain couvre le secteur de l'Ebre jusqu'au delta, Navarrais et Galiciens sous Aranda opèrent une reconversion vers le sud, et progressent le long de la côte, occupant sans difficulté Castellon le 16 juin, tandis que Varela dispose du corps d'armée de Castille et du C.T.V. dont les éléments motorisés joueront ici encore un rôle décisif. Il s'agit d'une nouvelle bataille de rupture; les forces concentrées par les républicains pour sauver Valence sont les dernières dont dispose Miaja, nommé commandant de la zone Centre-Sud. Il n'y a plus de réserves. Les seuls renforts, si nécessaires pourtant, ne pourraient être prélevés que sur l'armée du Centre, ce qui risquerait de dégarnir dangereusement, pour la première fois, la défense de Madrid. Franco escompte la chute prochaine de Valence, troisième ville d'Espagne et hier encore siège du gouvernement, un succès de prestige au moins aussi important que la conquête du Levant qui priverait la zone Centre-Sud, où la situation alimentaire est déjà précaire, d'une région indispensable à son ravitaillement. Mais les difficultés de l'opération exigeront une préparation de deux mois; la « bataille du Levant » ne s'engagera pas avant l'été. Le 15 juillet, elle est déclenchée avec de gros moyens matériels, de part et d'autre de Teruel. Les 13° et 17° corps républicains doivent se replier; les armées de Varela et d'Aranda font leur jonction et atteignent la ligne Viver-Segorbe. Du 20 au 23, après d'intenses préparatifs d'artillerie, se succèdent les attaques de chars et d'infanterie contre la ligne fortifiée. Mais, finalement, l'offensive échoue.
Entre mai et juillet, conscient du péril que court la zone Sud, l'état-major républicain a en effet regroupé des troupes et lancé la contre-attaque de l'Ebre qui obligera l'état-major nationaliste à relâcher son étreinte contre le Levant. Valence est provisoirement sauvée. Cependant, depuis juillet 38, la situation militaire des républicains s'est considérablement détériorée. L'Aragon est perdu, la défense du Maeztrazgo reste précaire. La preuve est faite définitivement de la supériorité matérielle des nationalistes, de la capacité de leur commandement à mener la guerre avec les moyens modernes dont il dispose. Enfin, la division de l'Espagne républicaine en deux zones est très grave, non seulement parce qu'elle rend difficile une stratégie d'ensemble, mais parce qu'elle sape les bases mêmes du régime politique imposé par le gouvernement Negrín, obligé de déléguer ses pouvoirs, dans une partie importante du territoire, aux autorités militaires. Séparées, les deux zones vont évoluer de façon différente sur le plan politique et la zone Centre-Sud échappera bientôt à l'influence directe du gouvernement. Entre-temps, le désastre d'Aragon aura eu une conséquence politique directe : une crise au sein même du gouvernement.
Le départ de Prieto du ministère de la Défense nationale est en effet l'événement politique le plus important qui se soit produit en zone républicaine depuis la chute de Largo Caballero. Il jette une note discordante dans le calme politique relatif et l'ambiance d' « union sacrée » qui ont suivi les événements du printemps 37.
Son importance provient d'abord de la personnalité du ministre. Prieto est très connu à l'étranger, et passe aux yeux de beaucoup pour l'homme de l'Angleterre. Ce socialiste jouit de la confiance des républicains et même d'un certain respect en zone nationaliste, où des historiens iront jusqu'à le considérer comme le seul homme politique valable de la zone « rouge ». Il a longtemps passé pour l'« homme fort » du gouvernement Negrín. On connaît la vieille amitié qui le lie au président dont il a, lors de la crise, mis en avant la candidature. On a même cru qu'il allait gouverner sous son nom. En fait, Negrín a pris sa tâche au sérieux, décidant par lui-même de toutes les questions essentielles, ne se dérobant à aucune responsabilité. Et très vite, les deux hommes ont rencontré des points de divergences : ils n'ont ni la même conception de la conduite de la guerre, ni surtout les mêmes perspectives, les mêmes espoirs quant à une issue heureuse du conflit. Leur polémique d'après-guerre révèle aussi une vive hostilité personnelle : si on n'en est pas encore là en mars 1938, leurs rapports se sont néanmoins suffisamment détériorés pour que Prieto soit éliminé du poste-clé qu'il occupait depuis la formation du « gouvernement de la victoire ».
La thèse de Negrín est que, devant la gravité de la situation militaire après la chute de Teruel et le désastre d'Aragon, il a dû renforcer l'exécutif pour accentuer l'effort et la volonté de guerre. Or, à ses yeux, le pessimisme de Prieto ne le rend pas apte à exercer, dans ces circonstances les fonctions de ministre de la Défense nationale. Comment en effet, confier la direction de la guerre à un homme qui ne croit pas à la victoire? C'est précisément pour renforcer l'exécutif que Negrín ne confiera pas le portefeuille de la Défense à une autre personnalité, mais qu'il s'en chargera lui-même, le cumulant ainsi avec la présidence.
Si Negrín affirme qu'il existe, en mars, un conflit au sein du gouvernement et que ce conflit est dû au pessimisme de Prieto, celui-ci fait simplement remarquer que ses sentiments n'ont pas varié et qu'ils étaient connus de tous notamment de Negrín, qui n'a pourtant pas hésité à le nommer ministre de la Défense nationale l'année précédente. De fait, lorsque Prieto quitte le ministère, en mars 38, ce ne sont pas ses opinions sur les perspectives de victoire militaire qui ont changé, mais la situation militaire en Espagne républicaine. La perte du Nord et le désastre d'Aragon conduisent à des options politiques se situant autour du dilemme : résistance ou négociation. Mais Prieto affirme que là n'est pas le motif de son élimination.
Pour lui, en effet, la responsabilité de la crise revient aux communistes : ce sont eux qui ont exigé son départ. Leur volonté de l'éliminer en est la seule et véritable cause. Il n'y a selon lui qu'un conflit, celui qui l'oppose au parti communiste : les ministres communistes Uribe et Hernandez ont tenté de l'associer à une direction « fractionnelle » socialiste-communiste du gouvernement, et son refus les a déterminés à le combattre. Il est incontestable que ce sont les attaques publiques de la Pasionaria, puis les articles de Hernandez signés Juan Ventura parus dans La Vanguardia et dans Frenie raja qui ont provoqué la crise, la protestation de Prieto auprès de Negrín contre cette rupture de la solidarité ministérielle, puis le remaniement et l'exclusion de Prieto. Mais, ainsi qu'il le répète avec force Prieto ne démissionne pas, il est renvoyé.
Reste à savoir si, comme il le prétend, la décision de le renvoyer a été imposée au président par le parti communiste. Il ne fait aucun doute que les dirigeants du P.C. ont, dans la mesure de leur influence qui était grande, poussé à son élimination. Il a été longtemps un de leurs plus précieux alliés; dans la lutte contre Largo Caballero, dans le gouvernement Negrín pendant de longs mois, ils ont été à ses côtés parce qu'il était un homme d'ordre dont les vues coïncidaient avec les leurs, parce qu'il était le seul homme politique capable de gagner la sympathie active des puissances occidentales, parce qu'il était, enfin, un partisan résolu de l'unité socialiste-communiste [9]. Il s'avère maintenant que cet allié refuse de devenir un instrument. Il refuse, au gouvernement, l'alliance qu'on lui propose. Ministre de la Défense nationale, il s'irrite de l'ingérence des techniciens russes et n'hésite pas à s'en prendre directement au parti communiste et à son influence dans certains secteurs[10], affichant délibérément son intention de le plier, lui aussi, à cette discipline de fer qu'il a tant réclamée. Cela Prieto ne le nie pas : il développe au contraire très longuement le récit de toutes les escarmouches qui l'ont opposé aux communistes et aux conseillers russes [11]. Il laisse pourtant dans l'ombre les raisons d'un revirement qu'il ne peut guère admettre dans la mesure où il serait obligé de reconnaître en même temps sa longue alliance avec le P.C. Les motifs de Prieto sont clairs : ils sont liés à l'évolution des événements politiques et militaires depuis la constitution du gouvernement qu'il a parrainé. Pour lui, l'appui communiste a été indispensable pour la restauration de l'État, comme l'avait été, dans les débuts, celui de Largo Caballero. L'État restauré, l'emprise communiste sur l'armée et la police lui paraît dangereuse à bien des égards. Sur le plan intérieur, il a assisté à la défection de nombre de ses fidèles: après la fraction de l'aile gauche qui suit Alvarez del Vayo, une importante fraction de l'aile droite, entraînée par lui dans la coalition antifasciste, semble, derrière Negrín, s'identifier sur tous les points avec l' « allié» communiste dont la puissance constitue, nous l'avons vu, un « État dans l'État ». Sur le plan extérieur, il a été semble-t-il très déçu par l'attitude des communistes et les conseils de prudence des Russes après le bombardement d'Almeria[12] ; sans doute a-t-il, à cette occasion, perdu une partie de ses illusions en constatant les limites de l'aide russe. Aussi va-t-il, à partir de cette date, accorder de plus en plus d'attention et d'importance à l'attitude de Londres et de Paris dont il est clair qu'elle ne se situe pas sur le même terrain que celle de Moscou. Certes, Prieto n'est pas autant qu'on l'a dit « l'homme de l'Angleterre », mais il est incontestablement l'homme d'une paix négociée dont l'Angleterre pourrait être l'agent. Dès mai 1937, il essaie de prendre des contacts avec les franquistes pour étudier les possibilités de négociation[13]. Quelques mois plus tard, profitant de l'échange de prisonniers qui va permettre la libération et le départ chez Franco de Fernandez Cuesta, il a avec le chef phalangiste plusieurs entrevues à ce sujet. Lorsque l'ancien prisonnier sera devenu ministre à Burgos, il tentera de reprendre le contact avec lui[14]. Or, que ce soit vis-à-vis de Franco ou vis-à-vis de Londres, la forte position des communistes dans l'État républicain constitue un obstacle aux négociations.
Après le désastre d'Aragon, Negrín veut avant tout durcir la résistance. Prieto, lui, ne croit plus qu'à la négociation. Il est probable que Negrín n'a pas eu à céder aux pressions des communistes: la logique de sa politique imposait le départ de Prieto, devenu, en même temps, son adversaire et celui du P.C.
L'élargissement des assises gouvernementales, par le retour de représentants des syndicats dans le gouvernement, permettrait-elle, comme l'ont affirmé les amis de Negrín, le renforcement de son autorité, malgré le départ de Prieto [15] ? Il est permis d'en douter, parce qu'il se produit au moment même où les nationalistes atteignent la Méditerranée et coupent en deux le territoire de la République. C'est par téléphone que Negrín doit confier au général Miaja la responsabilité du pouvoir politique et militaire dans la zone Centre-Sud: la coalition politique au pouvoir repose de plus en plus sur le consentement et la collaboration des chefs de l'Armée qui, bientôt, se dresseront contre elle.
Pour le moment, malgré le désastre d'Aragon, Negrín a choisi la résistance. Alvarez del Vayo, son bras droit, affirme: « Grâce à l'énergie et à la force d'âme montrées par le Président durant ces jours d'angoisse, les conséquences du désastre furent considérablement réduites. » Et il ajoute cet hommage à celui dont il fut le fidèle lieutenant: « On ne peut enlever au docteur Negrín le mérite d'avoir sauvé la situation en 38 et d'avoir rendu possible la continuation de la guerre une année de plus. » Negrín et Del Vayo pensent en effet, en avril 38, que le seul fait de « tenir» donne encore à la République une chance de vaincre. Tous deux croient que la guerre européenne est proche et qu'elle peut sauver l'Espagne. A une condition cependant: que ne soit pas auparavant consommé l'abandon de la République.
Notes
[1] Il a toujours été dans le caractère de Franco de se refuser à admettre une défaite qui porterait atteinte à son prestige. A Teruel, comme plus tard sur l'Ebre, il s'engage à fond, même s'il ne s'agit que de réparer un échec local. Sa prudence, d'autre part, lui interdit de lancer où que ce soit une opération de grande envergure, alors que le front est menacé ailleurs.
[2] Archives de la Wilhelmstrasse, 28 janvier 38.
[3] Aranda dispose de 300 batteries.
[4] Précisions empruntées à Rojo et aux articles de presse, notamment. du Temps.
[5] Galland signale la première apparition des pièces de 20 mm l'affût quadruple sur le front de Teruel.
[6] Le Temps, 6 janvier 38.
[7] Voir à ce sujet les critiques émanant des milieux dirigeants du Mouvement libertaire, notamment le document signé par Mariano Vazquez intitulé Critique de la prise de Teruel, cité par Peirats.
[8] Rojo signale que pendant quatre heures, le 31 décembre, Teruel était effectivement perdue par les républicains.
[9] Après la guerre, Prieto s'est efforcé de jeter un voile sur cette alliance gênante pour lui. Aussi minimise-t-il toujours son propre rôle, exagérant celui du P.C. et rejetant sur les seuls communistes des responsabilités qu'il avait en fait partagées avec eux. Par exemple, bien des auteurs imputeront au communiste Lister la responsabilité de la répression contre les collectivités aragonaises, alors qu'il est certain que Lister agissait ici sur l'ordre de son ministre.
[10] Cf. les brochures polémiques de Prieto. Ce sont eux qui, selon lui, empêchent le Ciscar de quitter le Nord, et portent donc la responsabilité d'une désobéissance qui aboutit à la perte de ce navire de guerre. C'est, selon lui, par-dessus sa tête, que les techniciens russes s'entendent avec Uribarri, le chef du S.I.M. Il s'étend aussi longuement sur ses démêlés avec le commandant Duran, communiste, chef du S.I.M. à Madrid et protégé par les techniciens russes. L'incident Anton est également très significatif. Ce membre du bureau politique, vraisemblablement amant de la Pasionaria, occupait d'importantes fonctions dans le Commissariat à Madrid. Or il appartenait à une classe mobilisée et aurait dû, à ce titre, quitter les bureaux pour être affecté à une unité combattante. Le P.C. demanda une mesure d'exception pour lui, et Prieto s'y refusa. Il est d'ailleurs intéressant de noter, toujours selon Prieto, que ce furent finalement des communistes qui eurent le dernier mot : Anton ne fut jamais affecté à une unité combattante.
[11] C'est dans cette optique qu'il faut replacer les mesures prises par Prieto au lendemain de la chute du Nord : limitation du nombre et du rôle des commissaires, interdiction faite aux officiers et aux unités de l'armée populaire de participer sans son autorisation à des manifestations politiques, etc.
[12] Cf. chap. VIII.
[13] Voir dans les archives de la Wilhelmstrasse un rapport de Faupel sur une entrevue avec Franco : selon ce dernier, Prieto, lors des Journées de mai, aurait contacté Blum pour la recherche d'une médiation américaine. Selon Stöhrer, dans une note du 3 décembre, Prieto aurait essayé d'entrer en contacts, par l'intermédiaire d'un de ses secrétaires, avec le commandant d'Irun.
[14] Voir il ce sujet Palabras al viento, pp. 233-238. Prieto précise que l'échange entre Fernandez Cuesta et le républicain Justino Azcarate fut proposé par Giral et qu'il s'y opposa personnellement. Il n'aurait finalement accepté que parce qu'il comptait sur l'influence que Fernandez Cuesta, libéré, pourrait exercer chez les franquistes pour une négociation. C'est après son départ du gouvernement qu'il fil une tentative pour renouer les contacts avec le chef phalangiste. Il y renonça après un entretien avec Negrin qui refusa de le « couvrir ».
[15] Dans un souci d'équilibre parlementaire, en même temps que Prieto, Negrin écarta le ministre communiste qui avait été à l'origine des incidents : Jesus Hernandez devenait vice-commissaire général de l'armée du Centre. Les adversaires du président firent remarquer que c'était la, en fait, un poste plus important que celui de ministre; les apparences, du moins, étaient sauvées. Par contre, il est impossible de suivre les amis de Negrin quand ils attribuent une grande signification à l'entrée dans le gouvernement de délégués de la C.N.T. et de l'U.G.T. En fait, Gonzalez Peña, de l'U.G.T., et Segundo Blanco, de la C.N.T., étaient considérés, dans leurs organisations, comme des « hommes de Negrin ». Leur entrée dans le gouvernement ne peut avoir la signification d'une adhésion des centrales à la politique de Negrin : elle ne fait qu'officialiser leur soumission.